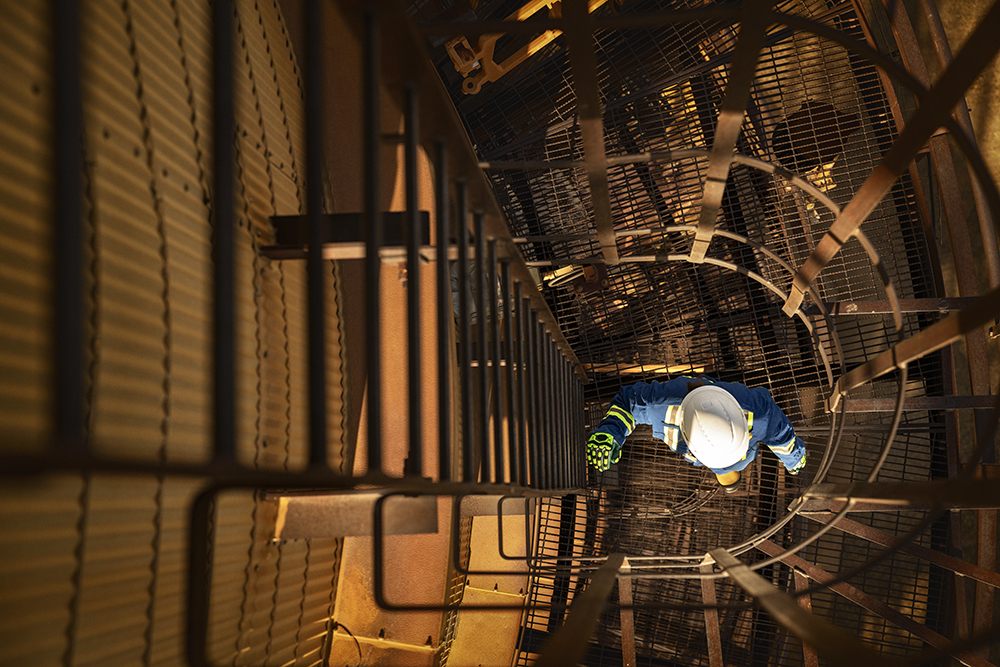À quel moment une nouvelle ligne de prospection sismique n’en est plus une?
7 novembre 2024
Le programme BERA cherche des réponses pour mieux comprendre et mesurer la régénération de l’écosystème boréal et enrichir les techniques de restauration.
On estime que 1,8 million de kilomètres de lignes de prospection sismique – des couloirs creusés sous la surface terrestre afin de découvrir du pétrole et du gaz – sillonnent la forêt boréale de l’Alberta. Il s’agit là d’un héritage des recherches de ressources naturelles menées à partir de 1929.
Par le passé, ces lignes étaient creusées à l’aide de bouldozeurs pour faire de la place au matériel d’imagerie sismique. Cette technique se sert de l’énergie des ondes pour analyser la géologie des sols et cartographier les gisements de pétrole et de gaz.
Au cours des dernières décennies, l’industrie de l’énergie a innové. Depuis les années 1990, l’usage de techniques de prospection sismique à faible impact visant à réduire la largeur et l’incidence de ces lignes s’est largement répandu. Cependant, les effets des pratiques passées restent visibles en de nombreux endroits. Dans un souci d’amélioration continue, il faut désormais comprendre comment la végétation se régénère et comment la faune s’approprie ces anciens couloirs.
« La forêt n’a pas repris ses droits le long de ces anciens couloirs de prospection sismique. Nous essayons de comprendre pourquoi et de déterminer les mesures à prendre pour revenir progressivement à une forêt boréale autonome », explique Robert Albricht, superviseur des activités environnementales chez ConocoPhillips Canada. « Ces couloirs subsistent parce que plusieurs caractéristiques physiques, liées notamment aux sols et aux eaux souterraines, ont été modifiées de manière artificielle. Le processus de régénération est donc différent de celui observé après des perturbations naturelles telles qu’un incendie ou une infestation de ravageurs. »
Si les lignes restent visibles depuis les airs et sur les images satellites, on ne sait toujours pas comment la faune de la forêt boréale utilise ces couloirs. M. Albricht participe à un important projet de recherche, le programme BERA (Boreal Ecosystem Recovery and Assessment ou évaluation et régénération des écosystèmes boréaux), qui recueille des données depuis plus de 10 ans afin de faire la lumière sur ce sujet. (Consultez le texte ci-dessous pour en apprendre davantage sur le programme BERA.
« La question essentielle est de savoir si ces anciennes lignes subissent encore l’effet de la prospection sismique ou si elles font aujourd’hui partie du paysage naturel. Comment la végétation s’est-elle régénérée dans ces couloirs? Comment la faune les perçoit-elle? Les utilise-t-elle comme voies d’accès privilégiées ou bien les évite-t-elle? Il est primordial de répondre à ces questions », résume M. Albricht. « Il s’agit là d’une problématique complexe où la nuance est de mise. En effet, nos recherches concernent non seulement l’écologie des forêts boréales, mais aussi un large éventail de plantes et d’animaux ainsi que de nombreux facteurs biophysiques influant sur la régénération de la végétation. C’est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. »
Mais selon M. Albricht, la portée et l’ampleur des recherches du programme BERA rendent ce casse-tête particulièrement fascinant.
« Il est inhabituel de voir autant de chercheuses et chercheurs provenant de domaines différents travailler ensemble sur une question apparemment simple, qui ne se prête pas à une réponse facile », indique-t-il.
Il conclut : « Grâce au programme BERA, nous nous efforçons d’enrichir notre compréhension des processus sous-jacents influençant la régénération des forêts. Nous nous attelons aussi à enrichir nos outils d’évaluation et de restauration écologique. À terme, nous espérons répondre à la question “À quel moment une nouvelle ligne de prospection sismique n’en est plus une?” Nous souhaitons également déterminer les mesures à prendre pour procéder à la restauration écologique de ces anciens couloirs. »
***
À propos du programme BERA
- Le projet a débuté en 2012 sous l’impulsion de l’Alberta Biodiversity Monitoring Institute (Institut de surveillance de la biodiversité de l’Alberta), un organisme sans but lucratif, et d’une vaste coalition d’établissements universitaires, d’entreprises privées et de ministères.
- Objectif du programme : comprendre les effets des perturbations industrielles sur la dynamique des écosystèmes de la forêt boréale et élaborer des stratégies de restauration des paysages touchés dans un environnement soumis à la pression des changements climatiques.
- Dirigé par la University of Calgary, la University of Alberta, la University of Waterloo et la Athabasca University, le projet a été financé grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
- Quatre entreprises membres de l’Alliance nouvelles voies – ConocoPhillips Canada, L’Impériale, Canadian Natural et Cenovus – participent au programme.
Le programme BERA réunit quatre équipes. Chacune se penche sur un axe de recherche précis visant à répondre à un objectif clé en matière de gestion stratégique.
- L’équipe Végétation, dirigée par Scott Nielsen de la University of Alberta :
- Cherche des moyens de régénérer la couverture forestière; travaille à définir les facteurs qui favorisent ou entravent cette régénération.
- Tente de comprendre pourquoi les anciennes lignes de prospection sismique sont aujourd’hui recouvertes d’arbustes et d’autres végétaux, tandis que la forêt environnante n’a toujours pas repris ses droits sur ces couloirs.
- L’équipe Sols et écohydrologie, dirigée par Maria Strack de la University of Waterloo :
- Étudie comment restaurer la dynamique naturelle du carbone, c’est-à-dire les variations et les mouvements du carbone organique dans un écosystème – les arbres et les autres plantes consomment du carbone et le stockent efficacement, tandis que la décomposition organique le libère.
- Examine les études et les solutions possibles afin de définir des pratiques exemplaires et de rétablir la dynamique naturelle du carbone.
- L’équipe Êtres humains et faune, dirigée par Erin Bayne de la University of Alberta :
- S’attelle à maintenir l’habitat faunique et à améliorer celui du caribou. Il s’agit non seulement de comprendre les effets des lignes de prospection sismique sur la régénération de la couverture forestière et le comportement de la faune, mais aussi d’étudier leurs répercussions éventuelles sur les populations d’espèces boréales et l’arrivée de nouvelles espèces.
- L’équipe Télédétection, dirigée par Gred McDermid de la University of Calgary :
- Se consacre à l’évaluation et au suivi de la restauration, en élaborant des flux de travail et des outils de planification pour détecter, cartographier et définir directement les différentes caractéristiques. Quand il est impossible de procéder à des mesures directes, l’équipe s’efforce de mettre au point des analogues télédétectés et d’évaluer dans quelle mesure ils sont liés aux processus et aux caractéristiques qui les intéressent.
À ce jour, l’équipe du programme BERA a publié des dizaines d’articles évalués par les pairs, y compris plusieurs faits saillants de la recherche. Consultez ici la liste complète de ces publications. Ces travaux ont contribué à faire progresser la science de la régénération et de l’évaluation des écosystèmes boréaux. Ils ont en outre permis d’élaborer des recommandations pratiques en matière de gestion ainsi que des outils pragmatiques (boîte à outils BERA). L’équipe du programme BERA a collaboré avec un large éventail de parties prenantes dans le cadre de nombreux ateliers et de plusieurs séances de stratégie, ce qui lui a permis de s’assurer de la pertinence des recherches en cours pour l’ensemble des partenaires du projet.