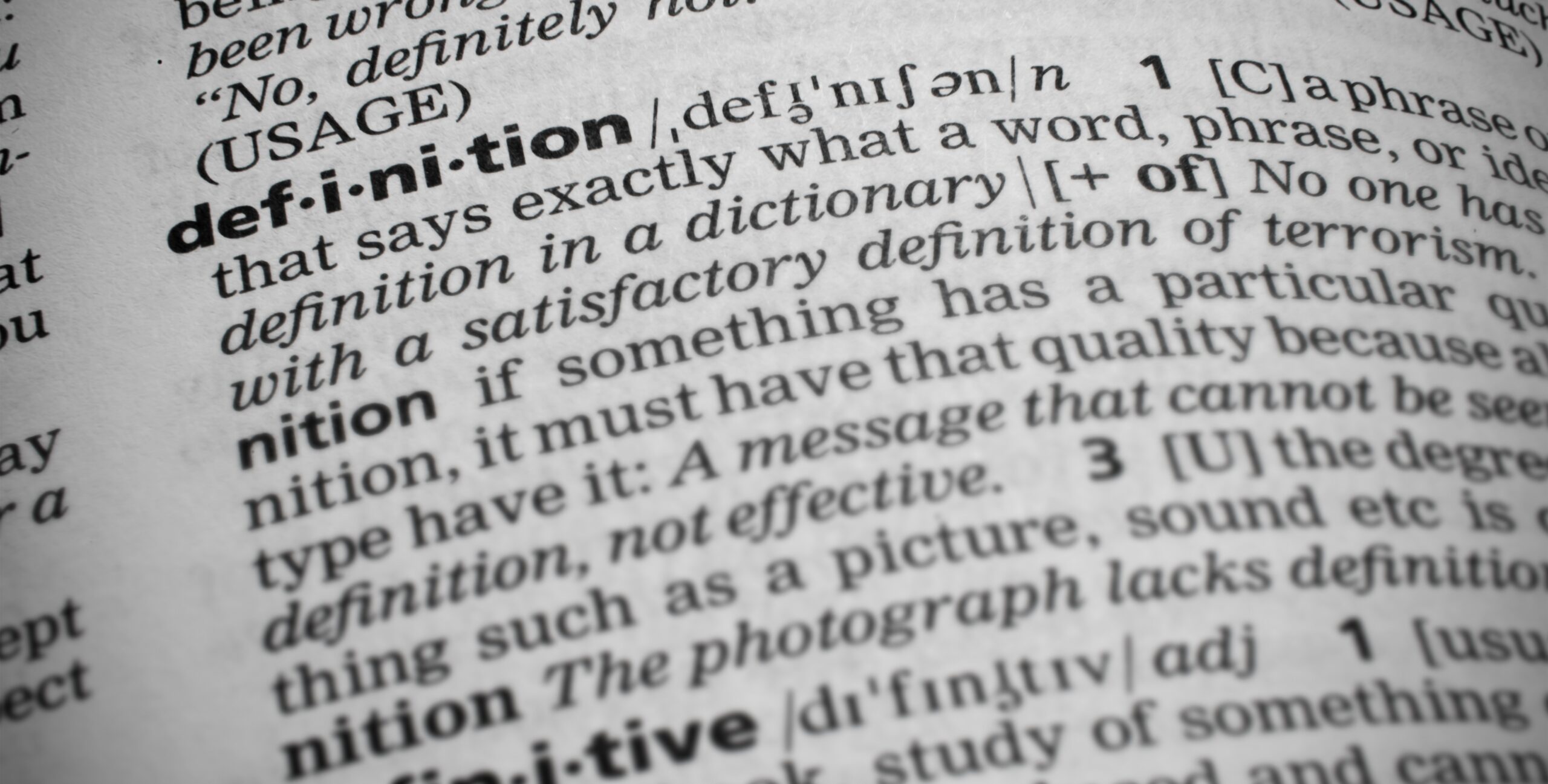Réflexion d’une scientifique : « Ce qui importe réellement, ce n’est pas la destination, mais le chemin parcouru. »
5 février 2025

Si l’on avait demandé à Lindsay Clothier, alors qu’elle était âgée de huit ans, de deviner le métier qu’elle allait exercer plus tard, elle aurait probablement évoqué quelque chose en lien avec les sciences. Cependant, elle était loin de se douter du parcours hors du commun qui l’attendait.
Lindsay Clothier est conseillère en gestion foncière auprès de l’Alliance canadienne pour l’innovation dans l’industrie des sables bitumineux (COSIA), la branche de l’Alliance nouvelles voies consacrée à l’innovation. Depuis son plus jeune âge, Lindsay est passionnée par la biologie, et elle se souvient encore de ses visites au centre des sciences avec sa sœur, ainsi que de son tout premier microscope.
« J’ai toujours voulu comprendre le monde qui m’entoure, et je crois que c’est cette curiosité qui m’a poussée à poursuivre des études en sciences. »
Ce sont les projets scientifiques à l’école dont elle garde le meilleur souvenir, qu’il s’agisse de construire une machine de Rube Goldberg à réaction en chaîne ou d’imaginer une forme de vie extraterrestre.
« Ce que je préfère à propos des sciences, c’est l’expérimentation. J’ai toujours aimé me retrouver en laboratoire, analyser les problèmes, explorer différentes méthodes pour les tester et envisager les solutions possibles. Ce qui me passionne vraiment, c’est comprendre le problème et tout le cheminement qui mène à la solution. »
Au moment d’entreprendre ses études postsecondaires, il était évident pour Lindsay que la biologie était la voie à suivre, même si elle s’imaginait alors faire carrière en médecine.
« Comme plusieurs, je me suis inscrite en biologie avec l’idée de devenir scientifique en laboratoire. Beaucoup choisissent cette voie pour devenir médecin, vétérinaire ou optométriste, mais moi, je m’imaginais chercheuse dans le domaine médical. »
Lors de la première année de baccalauréat de Lindsay, la plupart des cours portaient sur la biologie cellulaire humaine, abordant diverses maladies et le fonctionnement des cellules. Ce n’est qu’après avoir suivi un cours de microbiologie, dispensé par le professeur Peter Dunfield, que Lindsay a commencé à reconsidérer ses ambitions professionnelles. À l’époque, celui-ci menait des recherches sur l’écologie microbienne environnementale.
« Le professeur Dunfield enseignait la microbiologie environnementale, et je me suis dit que c’était vraiment fascinant! La plupart des gens associent les sciences de l’environnement aux plantes et aux animaux, mais avant ce cours, je n’avais jamais vraiment réfléchi à ce qui se passe sur les plans cellulaire et microbien. J’ai rapidement été captivée par tout ce qui échappe à l’œil nu. »
La curiosité de Lindsay l’a poussée à s’investir pleinement dans cette nouvelle voie. Le cours de microbiologie s’est avéré être son préféré, au point qu’elle a même eu l’occasion d’en enseigner une partie après avoir obtenu son diplôme. En troisième année, elle souhaitait mener un projet de recherche dans le cadre de son baccalauréat. Elle a alors intégré l’équipe de la professeure Lisa Gieg, qui, à l’époque, mettait en place son laboratoire de microbiologie pétrolière à l’Université de Calgary. Ses recherches portaient notamment sur la biodégradation et la corrosion microbienne. Le projet de Lindsay consistait à étudier des microorganismes anaérobies, capables de survivre sans oxygène, dans les bassins de résidus des sables bitumineux.
« Au départ, l’équipe de recherche était exclusivement féminine. C’était une expérience exceptionnelle d’apprendre et de travailler aux côtés de femmes remarquables sur des projets aussi intéressants. Mon objectif était de comprendre ce que les bactéries consommaient dans cet environnement anaérobie de bassin de décantation et comment elles s’y prenaient. »
Ces recherches ont mené à la toute première publication scientifique de Lindsay.
À la fin de ses études, Lindsay était prête à entrer sur le marché du travail. Cependant, une fois de plus, les choses ont pris une tournure inattendue. La professeure Gieg avait un nouveau projet en tête et souhaitait que Lindsay fasse partie de son équipe, mais cette fois en tant qu’étudiante diplômée.
« À l’époque, je me disais que je ne voulais pas faire de maîtrise. J’avais terminé mes études et j’étais prête à intégrer le marché du travail. Mais peu à peu, l’équipe a réussi à susciter mon intérêt avec le projet de recherche et a fini par me convaincre d’entamer des études supérieures. »
Les travaux de maîtrise de Lindsay s’inscrivaient dans un projet plus vaste dirigé par le professeur Gordon Chua, en lien avec l’objectif prioritaire de la COSIA concernant l’environnement hydrique. Ce projet portait sur les algues et les bactéries présentes dans l’eau des résidus des sables bitumineux, ainsi que sur les effets de cette eau sur les poissons, les escargots et les plantes. L’un des objectifs de la recherche était de déterminer si les algues pouvaient décomposer certains composés de l’eau des résidus, contribuant ainsi à un traitement plus efficace de l’eau. Lindsay a cultivé des algues, procédé au séquençage de l’ADN et analysé les bactéries présentes afin de comprendre leur interaction avec l’eau des résidus.
Une fois sa maîtrise obtenue, Lindsay a débuté sa carrière dans un laboratoire de toxicologie aquatique pendant quatre ans, tout en continuant à gérer des projets auprès de la COSIA dans le cadre de ses fonctions. Lorsqu’un poste au sein de la COSIA s’est présenté, il était évident pour elle qu’il s’agissait d’une occasion en or.
« Je ne m’attendais pas à travailler dans l’industrie pétrogazière. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre pourquoi des biologistes, en particulier ceux qui se spécialisent en environnement, choisissent de travailler dans cette industrie. Mais moi, je veux être sur le terrain et contribuer à faire changer les choses. Nous savons tous que l’extraction des ressources a un impact sur l’environnement, mais à ce stade-ci de notre évolution, ces ressources demeurent essentielles à la vie moderne. La question à se poser est donc “comment pouvons-nous réhabiliter1 le terrain pour obtenir les meilleurs résultats?” »
Cela résume bien le travail de Lindsay au sein de la COSIA, une organisation qui regroupe des entreprises œuvrant dans le domaine des sables bitumineux, dont l’objectif est de collaborer pour faire progresser l’innovation et les technologies environnementales. Dans le cadre de l’axe d’intervention consacré à l’environnement terrestre, Lindsay travaille avec les membres pour trouver des solutions visant à réduire l’impact de l’exploitation des sables bitumineux sur le terrain et sur la faune.
« J’aime pouvoir explorer une autre facette des sciences dans mon travail. Les membres de la COSIA possèdent une expertise exceptionnelle, et j’apprécie la diversité des recherches dans ce domaine, qui portent aussi bien sur les sols et la végétation que sur les caribous et les oiseaux migrateurs. »
En mars, cela fera quatre ans que Lindsay travaille pour la COSIA. Avec du recul, elle est bel et bien devenue la scientifique en blouse de laboratoire qu’elle avait toujours rêvé d’être. Cependant, son parcours a été ponctué de tournants inattendus.
Lorsqu’on lui demande quel conseil elle donnerait aux jeunes intéressés par les sciences, elle leur dirait de garder l’esprit ouvert.
« Explorez toutes les possibilités! Vous pensez peut-être savoir ce que vous voulez étudier ou la carrière que vous souhaitez poursuivre, mais les sciences offrent un champ d’exploration infini. Osez découvrir, car le chemin qui mène à une découverte peut être aussi gratifiant que le but à atteindre. »
- Les termes « réhabilité » et « réhabilitation » font référence aux activités de réhabilitation d’un terrain, sans pour autant indiquer une « réhabilitation permanente » ni un statut de terrain réhabilité « certifié ». Ces désignations suivent les dispositions de mise en œuvre spécifiées (Specified Enactment Direction, SED) 001 et 003 de l’Alberta Energy Regulator (AER), organisme de réglementation de l’énergie en Alberta. ↩︎