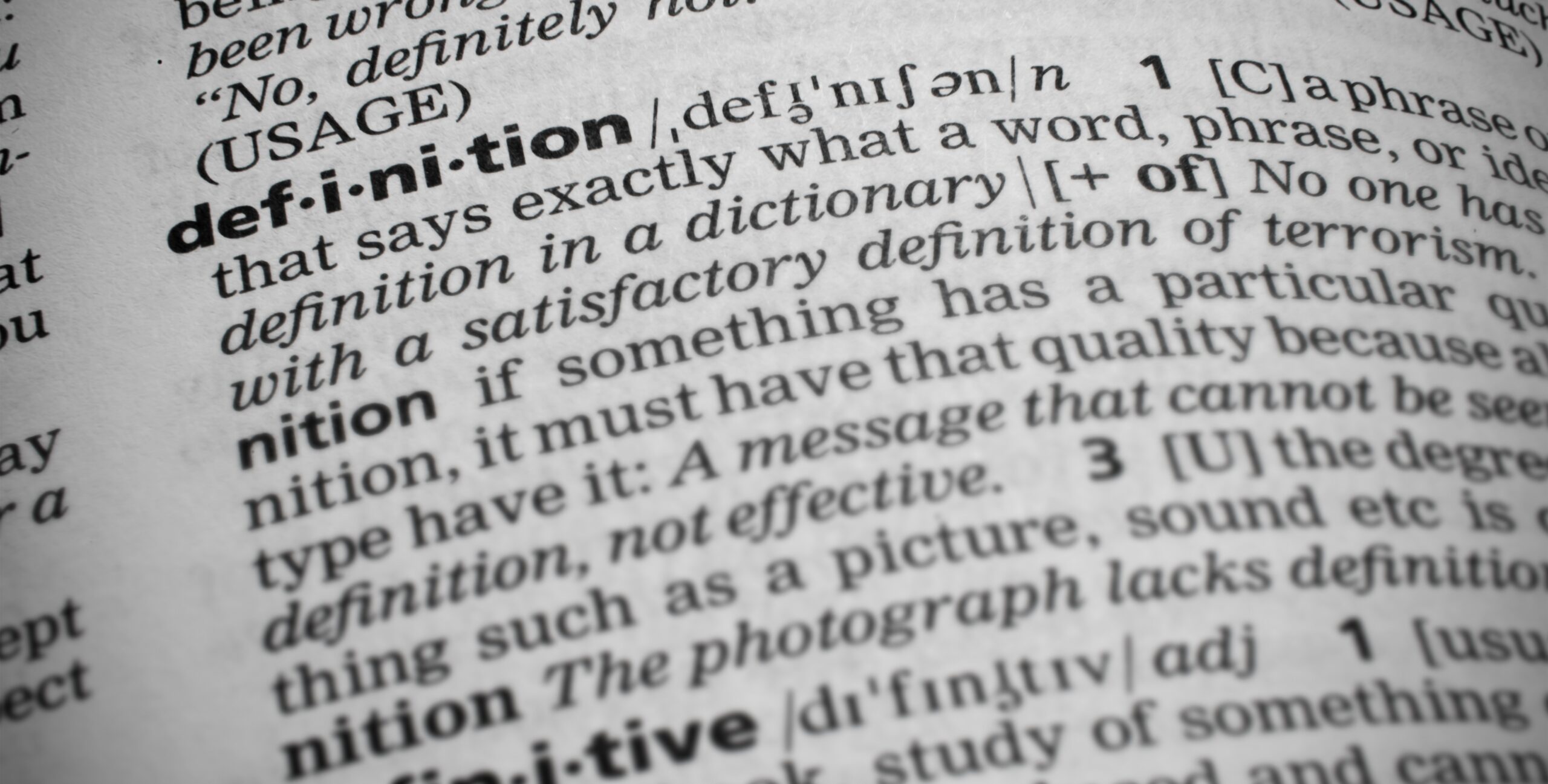L’art de la séparation : moteur de progrès dans les sables bitumineux et le génie biomédical
18 août 2025

Depuis près de trois décennies, Hongbo Zeng étudie minutieusement la manière de séparer efficacement les émulsions, c’est-à-dire deux liquides maintenus dans un état hétérogène temporairement ou à long terme.
Ce professeur de l’Université de l’Alberta a mis son expertise au service de l’amélioration des procédés d’exploitation des sables bitumineux, tout en recherchant de meilleures façons d’aider les médecins à diagnostiquer et traiter leurs patients.
« Depuis mon arrivée à l’Université de l’Alberta en 2009, notre laboratoire collabore avec l’industrie des sables bitumineux, notamment avec les entreprises membres de l’Alliance nouvelles voies », indique M. Zeng, professeur au département de génie chimique et des matériaux. « Nous travaillons à l’amélioration du traitement des mélanges d’eau et d’huile, en mettant l’accent sur l’innovation environnementale et la réduction des coûts d’exploitation des opérations in situ. »
Environ 80 % des gisements de sables bitumineux en Alberta sont situés trop profondément sous terre pour être exploités à ciel ouvert. Leur extraction repose donc sur des techniques in situ, qui consistent à injecter de la vapeur dans le sous-sol pour chauffer le bitume, permettant ainsi son pompage jusqu’à la surface. Dans ce processus, une séparation efficace entre l’eau et le pétrole est cruciale. « L’eau utilisée est recyclée et doit être traitée pour éliminer les résidus de pétrole, ainsi que les matières inorganiques et organiques en suspension ou dissoutes », explique M. Zeng, titulaire depuis 2017 de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en force intermoléculaire et science des interfaces. « Les composés inorganiques, comme la calcite, peuvent entraîner la formation de dépôts, tandis que les matières organiques en suspension ou dissoutes peuvent encrasser les équipements, en particulier les échangeurs utilisés pour refroidir l’eau produite ou pour chauffer l’eau dont la vapeur sert au processus d’extraction. »
M. Zeng et son équipe ont mis au point des additifs chimiques capables d’améliorer l’efficacité de la séparation du pétrole et de l’eau, tout en facilitant l’élimination des solides dissous.
« Nous avons collaboré avec les membres de l’Alliance nouvelles voies, qui nous ont fourni des échantillons issus de leurs exploitations. Chacune d’elles peut présenter une chimie de l’eau unique et légèrement différente, ainsi que des particularités considérables quant au bitume extrait », explique M. Zeng. « L’objectif de nos recherches a donc consisté à déterminer les additifs les mieux adaptés à chaque contexte, car une séparation inefficace peut entraîner des perturbations, voire des interruptions de l’exploitation. Les opérateurs souhaitent éviter ces situations tout en assurant un recyclage optimal de l’eau. Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis jusqu’à présent. »
Parallèlement, l’équipe de recherche de M. Zeng a également mis son expertise au service d’autres domaines, y compris pour surmonter des défis auxquels les médecins et les patients sont confrontés. Cette recherche a d’ailleurs donné lieu à deux demandes de brevets en cours.
Le premier brevet concerne un nouveau revêtement destiné aux récipients d’échantillons et aux tubes utilisés pour recueillir et conserver des fluides biologiques, comme le sang.
« Le bio-encrassement est un problème bien connu : certains composants des fluides biologiques, comme les protéines ou les cellules, peuvent adhérer aux parois des porte-échantillons ou des tubes insérés dans le corps », affirme-t-il. « Cela peut altérer la qualité des échantillons et potentiellement entraîner des erreurs de diagnostic. Nous avons mis au point un revêtement qui empêche l’adhésion des protéines et des cellules sanguines aux parois des tubes et des récipients. Nos résultats ont fait l’objet d’une publication scientifique et une demande de brevet a été déposée. »
M. Zeng et son équipe ont également déposé une deuxième demande de brevet portant sur un substitut aux tiges en alliage de titane que l’on insère dans le corps des patients pour favoriser la guérison des fractures osseuses.
« Les chirurgiens utilisent généralement des alliages de titane, car ces matériaux sont solides, résistent à la corrosion et favorisent la consolidation osseuse », explique M. Zeng. « Toutefois, ces implants doivent parfois être retirés, ce qui nécessite une seconde intervention chirurgicale et plusieurs mois de convalescence, une étape souvent coûteuse et pénible pour le patient. »
Son équipe de recherche a imaginé un matériau biodégradable et non toxique, équipé d’un revêtement spécial qui se dissout naturellement après quelques mois, une fois que l’os est suffisamment cicatrisé.
« Les os mettent généralement de trois à quatre mois pour guérir », explique M. Zeng. « Nous avons trouvé un revêtement non toxique capable de dissoudre le matériau servant à fixer l’os, évitant ainsi une seconde intervention chirurgicale. Nous n’avions pas de financement spécifique pour ce projet, mais trouvant ce défi particulièrement intéressant, nous avons décidé de nous y consacrer. Nos recherches ont été publiées et une demande de brevet a été déposée. »
Qu’il s’agisse de résoudre des difficultés opérationnelles liées à l’industrie des sables bitumineux ou d’aider des patients à guérir, M. Zeng aime relever des défis et trouver des solutions innovantes.
« Nous avons une équipe formidable au laboratoire, ainsi que des partenaires industriels fiables et enthousiastes à l’idée de nous accompagner dans ces défis », déclare-t-il. « Les sables bitumineux constituent une ressource essentielle pour l’Alberta et le Canada. Nous espérons que nos recherches favoriseront l’innovation, tant sur le plan environnemental qu’opérationnel. »